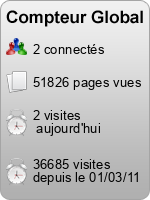article publié dans "Le Droit ouvrier"
par Thierry DURAND, Conseiller prud’homme
et Patrick HENRIOT, Magistrat

Le Conseil de prud’hommes est sous les feux de l’actualité : scruté dans son fonctionnement, comme les autres juridictions de première instance, en vue d’élaborer une ambitieuse justice du XXIe siècle (1), il est également l’objet d’un projet de réforme substituant à l’élection de ses membres une désignation par les organisations syndicales et patronales (2).
C’est dans ce contexte qu’a été rendu le rapport sur les Juridictions du 21e siècle, désigné sous le nom de rapport Marshall (3). Le recours à cette méthode, qui s’appuie sur un groupe de travail composé, notamment, d’experts, appelle d’autant moins d’objections qu’elle permet, en principe, d’espérer un état des lieux partagé, quitte ensuite à ce que des divergences se fassent jour sur les voies de réforme (4). Au cas particulier, la déception est pourtant vive, à tout le moins s’agissant des propositions relatives à la juridiction prud’homale : prenant le risque de « mettre la charrue avant les boeufs », le rapport « plaque » des propositions de réforme sur la foi d’une connaissance manifestement superficielle de cette institution.
C’est pour mettre en garde contre les errements auxquels aboutit inévitablement une telle démarche que cet article propose de battre en brèche certaines idées reçues, fréquemment mobilisées dans le débat actuel. Qu’elles figurent implicitement ou explicitement dans le rapport Marshall ou qu’elles aient été relayées par d’autres autorités, quatre critiques récurrentes, dont nous contestons la pertinence, reviennent en boucle : le taux de conciliation prud’homale serait insuffisant (I) ; le taux d’appel, élevé, manifesterait les carences de cette juridiction (II) ; le taux de départage, considéré comme élevé, serait une preuve d’échec du paritarisme (III) ; enfin, des délais de jugement excessifs devraient conduire à abandonner les spécificités de la procédure prud’homale (IV). Si nous arvenons à convaincre le lecteur, à l’issue de ces quelques pages, que l’identification des maux de la justice prud’homale et la détermination des remèdes à y apporter méritent un examen plus objectif et une analyse plus aboutie que le diagnostic hâtif et l’ordonnance radicale qui nous sont proposés, alors nous pourrons espérer avoir apporté une contribution au débat sur une meilleure justice pour ce 21e siècle.
I. Un taux de conciliation insuffisant ?
Les critiques adressées à la non-conciliation
Avant de livrer ses propositions pour une réforme de la justice du travail (5), le Président de la Chambre sociale de la Cour de cassation identifiait « l’échec trop fréquent des phases de conciliation obligatoire devant les Conseils de prud’hommes » comme l’une « des causes de déni de justice inacceptables dans un système fondé sur l’État de droit » (6). C’est pourtant mal à propos que le spectre du déni de justice est brandi dans cette condamnation sans appel de l’activité des bureaux de conciliation.
Convenons d’abord que, face à des parties qui rechignent à transiger – pour des raisons multiples, complexes et pas nécessairement toutes illégitimes – les conseillers prud’hommes qui échouent à les convaincre ne les privent pas pour autant de la décision d’un juge. C’est même exactement l’inverse, puisque l’absence de conciliation aboutit au renvoi des parties devant le bureau de jugement, qui donne alors une issue judiciaire au litige.
Et s’il s’agit de suggérer que le préliminaire obligatoire de conciliation allongerait la procédure, au point d’être l’une des causes des délais déraisonnables de traitement du contentieux prud’homal (sanctionnés par le Tribunal de grande instance de Paris au printemps 2012 par une série de soixante et onze jugements condamnant l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice (7)) l’argument peine tout autant à convaincre. D’abord parce que la durée moyenne de traitement des affaires par les bureaux de conciliation, soit 2,5 mois (8), n’a qu’une incidence marginale sur la durée des procédures. Ensuite et surtout parce qu’il résulte de cette série de jugements rendus en 2012 dans le cadre d’actions concertées d’avocats du Syndicat des avocats de France (9) que « le retard mis à évoquer l’affaire n’était justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais bien par l’encombrement du rôle » et que « manifestement, ces délais excessifs résultent du manque de moyens de la juridiction prud’homale » (10) (une critique comparable avait été exprimée deux ans auparavant (11) ; elle a été renouvelée depuis (12)).
Si cette charge contre les bureaux de conciliation manque donc en fait aussi bien qu’en droit, elle n’en concourt pas moins à saper la crédibilité de l’institution prud’homale, comme trop de blâmes péremptoires qui font l’économie de l’examen attentif d’une réalité complexe.
Pourquoi ne pas avouer, plus simplement, que la diminution continue du taux de conciliation inquiète assez naturellement ceux qui n’apprécient l’efficacité de l’institution judiciaire qu’à l’aune d’impératifs gestionnaires, pour qui la « rentabilité » d’une audience du bureau de conciliation s’évalue selon un ratio coût budgétaire / nombre d’affaires sorties du stock ?
Mais en dépit des légitimes réserves que cette approche comptable de l’activité juridictionnelle peut susciter (13), il n’en demeure pas moins que le préliminaire de conciliation constitue, avec le paritarisme et l’élection des juges, l’ADN de l’institution prud’homale. C’est pourquoi il faut loyalement tenter de comprendre les causes de la baisse, bien réelle, du taux des affaires qui se terminent par un accord conclu sous l’égide du bureau de conciliation, évaluer dans quelle mesure il faut la déplorer – ou, pourquoi pas, s’en réjouir – et, si l’on considère qu’il faut y remédier, distinguer les fausses des vraies bonnes solutions.
Le taux de conciliation : de quoi parle-t-on ?
Pour bien évaluer le phénomène, on rappellera d’abord que, si toutes les transactions ne sont pas scellées dès l’audience initiale, la moitié des décisions qui mettent fin au litige sans trancher le fond traduit un accord des parties (14). Or ces décisions – conciliation, désistement et retrait du rôle – représentent elles mêmes 40 % des affaires introduites au fond ayant pris fin en 2012. Autrement dit, 20 % des affaires terminées en 2012 l’ont été par accord des parties, ce qui conduit à constater que le taux de 9,7 % d’affaires terminées dès l’audience initiale se double d’un taux légèrement supérieur d’affaires transigées en aval de cette audience. Même lorsque les conseillers n’ont pas immédiatement réussi à convaincre, leurs incitations – relayées par des avocats qui n’ont pas tous l’obsession du contentieux, contrairement à ce qui est trop souvent suggéré mezzo voce – permettent donc aux parties de s’engager sur la voie d’un accord dans un dossier sur cinq, ce qui reste significatif.
Pour autant, peut-on se satisfaire d’un taux de conciliation qui diminue continuellement, alors même que le préliminaire obligatoire de conciliation a été institué dans l’intérêt bien compris des parties au litige prud’homal ?
Les multiples raisons de ne pas se concilier
La réponse à cette délicate question est directement corrélée à l’identification des causes profondes du phénomène d’érosion. Une analyse superficielle et mécaniste du phénomène se focaliserait, en effet, sur la seule observation d’attitudes inappropriées des différents acteurs du processus, sans y trouver d’explications assurées et probantes :
- réticences, réelles ou supposées, d’avocats qui assistent de plus en plus souvent les parties (82 % aujourd’hui, contre 72 % en 2004) ;
- absences récurrentes d’employeurs, qui n’estiment pas nécessaire de se plier aux convocations de cette « sous-juridiction » ;
- ignorance, feinte ou réelle, de conseillers qui affirment que la conciliation doit être recherchée « dossiers fermés » ou « sans aborder le fond » ;
- à quoi il faudrait ajouter la pression gestionnaire qui s’exerce sur les personnels du greffe et, à travers eux, sur les conseillers, restreignant toujours plus le temps disponible, mais nécessaire, pour mener à bien le processus de rapprochement des parties.
Si ces différentes manifestations d’une même résistance de principe à la recherche d’une solution transactionnelle sont sans doute à l’origine d’une part non négligeable des échecs des tentatives des conciliations – dans des proportions qui restent difficiles à mesurer – elles ne permettent pas d’expliquer, en revanche, que le taux de conciliation ait pu chuter au point de s’être élevé à 80 % avant la Seconde guerre mondiale pour n’atteindre que 10 % aujourd’hui.
Il faut donc chercher ailleurs les causes de cette régression, et s’intéresser, sans doute, à l’évolution de la nature même de la fonction conciliatrice du procès prud’homal. Il se pourrait bien, en effet, que l’audience de conciliation n’ait été très longtemps regardée que comme l’occasion de conclure « un mauvais arrangement plutôt qu’un bon procès », selon un adage populaire qui convainc d’autant plus facilement les salariés qu’ils n’ignorent rien du déséquilibre des forces qui caractérise la relation de travail subordonnée. Dans cette approche pragmatique, la tentative de conciliation était sans doute perçue comme offrant moins la possibilité de revendiquer et voir satisfaire des droits clairement identifiés que d’obtenir immédiatement partie au moins de salaires, indemnités ou accessoires, dont un paiement trop longtemps différé compromet gravement les ressources du salarié. Au demeurant, les contours plus flous et le contenu moins substantiel des droits découlant, il y a quelques décennies, de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail en faisaient des contrepoids moins efficaces à la tentation d’obtenir immédiatement partie de son dû, fût-ce au prix de conséquents abandons de créances.
Singulièrement, le droit du licenciement d’avant 1973 offrait si peu de garanties – tant procédurales ou probatoires que de fond – que l’aléa judiciaire affectant la contestation de la rupture s’en trouvait inversement accru, incitant fortement à la conclusion d’un accord.
Or, si les Conseils de prud’hommes sont aujourd’hui saisis de demandes qui restent massivement en lien avec la rupture du contrat de travail (15), le droit qui la régit a considérablement évolué, en même temps que la finalité même de l’audience initiale de conciliation, dans la perception qu’en ont les salariés (à 98,3 % les initiateurs du litige prud’homal). Ces salariés, plus attentifs au respect de droits mieux cernés et moins incertains, ne sont, au demeurant, pas les seuls à vouloir, aujourd’hui, faire de l’audience initiale l’occasion de la reconnaissance effective et complète de ces droits.
La Cour de cassation elle-même a solennellement salué ce changement de perspective avec le
remarquable arrêt Durafroid (16), dont les attendus ont été réitérés (17). En attendant du bureau de conciliation une participation active à la recherche d’un accord des parties « préservant les droits de chacune d’elles », et en approuvant l’annulation d’un procès-verbal de conciliation par lequel « le salarié n’avait obtenu en contrepartie de son désistement que des sommes qui lui étaient dues », cet arrêt majeur n’a-t-il pas consacré, en effet, une conception de la conciliation prud’homale bien plus exigeante qu’elle ne l’était dans les décennies précédentes ? Une conception dans laquelle le champ de la transaction est aujourd’hui circonscrit aux seules prétentions du demandeur affectées d’un véritable aléa judiciaire, les sommes dues sans contestation sérieuse ne pouvant, au contraire, être abandonnées, ni en tout ni même en partie, au nom d’un accord global (alors que de tels accords étaient autrefois conclus « ex aequo et bono »).
Si l’on ajoute que cet aléa doit être mesuré, toujours selon le même arrêt, par des parties « informées de leurs droits respectifs » – l’office du bureau de conciliation consistant, notamment, à s’assurer que tel est bien le cas – on admettra volontiers qu’il devient autrement difficile de les convaincre de transiger en tenant compte, tout à la fois, des garanties objectives que procure le droit du licenciement et des exigences d’équilibre de l’accord à construire. Dans ces conditions, il apparaît assez peu étonnant, finalement, que le taux de conciliations ait à ce point régressé.
Faut-il vraiment s’en désoler ? Rien n’est moins sûr : on aurait mauvaise grâce à se plaindre de la meilleure protection des droits des salariés qu’a pu offrir le droit du travail, ou à critiquer le choix de ceux qui préfèrent se tourner vers la juridiction de jugement lorsqu’il leur est suggéré de renoncer au procès en contrepartie des seules sommes qui leur sont manifestement dues (18).
Quel avenir pour le bureau de conciliation ?
Faut-il alors, pour autant, abandonner le préliminaire de conciliation obligatoire ? Certainement pas : il conserve, bien sûr, ses vertus pacificatrices, et doit pouvoir favoriser des accords qui permettent aux deux parties d’éviter les délais et aléas des procédures contentieuses. Pour les salariés, singulièrement, la nécessité d’obtenir rapidement le paiement de sommes qui permettront de satisfaire des besoins alimentaires constitue souvent un enjeu majeur qui donne tout son prix à la recherche d’un accord « à l’ombre du juge ».
Il n’y a donc pas de raisons de renoncer à favoriser par tous les moyens la conclusion d’accords suscités et contrôlés par un bureau de conciliation déterminé à remplir pleinement son office.
La funeste barémisation des indemnités de rupture inaugurée par la loi du 14 juin 2013, paradoxalement dite « de sécurisation de l’emploi », est évidemment aux antipodes de cet objectif : en forfaitisant l’évaluation du préjudice sur lequel la discussion est censée s’instaurer, elle pourrait rendre passif un bureau de conciliation que la Cour de cassation veut au contraire, à juste titre, voir actif et elle annihile toute capacité d’adaptation de l’accord à la réalité de la situation des parties.
Il est clair, en revanche, que des progrès substantiels pourraient être obtenus en privilégiant notamment deux axes d’évolution. Il conviendrait, d’une part, d’assurer la diffusion et l’application effective de la « démarche Durafroid », telle que la Chambre sociale l’a parfaitement précisée et dont tous les bureaux de conciliation devraient acquérir la maîtrise : trop de réticences des différents acteurs de la tentative de conciliation laissent encore cette jurisprudence à l’état de voeu pieu (18 bis).
Le préliminaire de conciliation devrait, d’autre part, être conçu et pratiqué comme le premier acte d’une audience initiale (19) dont les différentes phases (recherche d’accord, mise en état de la procédure et, le cas échéant, décisions provisionnelles) s’inscrivent dans un processus global. C’est dans le continuum de ce processus que la tentative de conciliation devrait s’intégrer plus étroitement (20). Il devrait ainsi être plus clairement admis par l’ensemble des acteurs que, dans le prolongement d’une vaine tentative de conciliation, le bureau de conciliation a le pouvoir de prendre des décisions, certes provisionnelles, mais contraignantes, et ce, tant pour garantir une instruction complète et loyale de l’affaire que pour faire droit à certaines prétentions du demandeur (21). Ainsi, celles qui ne soulèvent pas de difficultés sérieuses devraient-elles être systématiquement identifiées dès la discussion tendant à la recherche d’un accord – ne serait-ce que pour déterminer, a contrario, le périmètre de celles qui, affectées d’un véritable aléa judiciaire, constitueront le champ de la démarche transactionnelle – et, à défaut d’accord, faire ipso facto l’objet de condamnations provisionnelles.
En facilitant l’évaluation des enjeux contentieux par les parties et en réduisant l’impact, négatif ou positif selon les points de vue, des délais de traitement par le bureau de jugement, la consécration de ce principe dans les textes favoriserait la conclusion d’accords équilibrés et en plus grand nombre. Bien entendu, l’ensemble de ces évolutions suppose que l’audience initiale soit abordée « dossiers ouverts » dès la tentative de conciliation, ce que suggèrent d’ailleurs explicitement les dispositions de l’article R. 1452-4 du Code du travail, aux termes desquelles la convocation en conciliation adressée au défendeur doit l’inviter à se munir de toutes les pièces utiles. Il conviendrait, toutefois, d’être plus exigeant et de prévoir que les parties sont tenues de se communiquer mutuellement leurs pièces au plus tard le jour même de cette audience initiale (22).
II. Un taux d’appel trop élevé ?
Les rapports et débats en cours comparent fréquemment le taux de 58 % d’appel frappant les décisions prud’homales avec celui de 12,5 % concernant les TGI, ou de 5,3 % à l’égard des décisions des TI (dont il faut souligner qu’une proportion importante est d’ailleurs rendue en dernier ressort). Ce rapprochement revient en boucle comme la signature de la faillite de l’institution prud’homale ou justifiant, à tout le moins, l’instauration urgente de l’échevinage (23). Cela revient, en creux, à instiller l’idée que les jugements rendus par les Conseils de prud’hommes sont à ce point médiocres que les justiciables sont contraints de s’adresser aux Cours d’appel pour avoir enfin affaire à des juges qualifiés ; ainsi, l’intervention d’un juge professionnel dès la première instance, sur le mode de l’échevinage, ferait gagner du temps et, mécaniquement, chuter le taux d’appel. Mais ces comparaisons, en apparence éclairantes, peuvent s’avérer trompeuses.
La spécificité de la demande prud’homale.
L’instance prud’homale présente l’originalité de concentrer dans une procédure unique l’ensemble des prétentions susceptibles d’être nées tout au long de l’exécution du contrat de travail ; pour se soustraire à d’évidents risques de représailles, les salariés ne formalisent le plus souvent qu’à l’occasion de la rupture du contrat des réclamations qui relèvent pourtant de son exécution. Cette concentration des demandes est, au surplus, favorisée par le principe de l’unicité de l’instance qui gouverne la seule procédure prud’homale et selon lequel toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l’objet d’une seule instance (24).
Dès lors, le litige que fait naître le licenciement concentre une addition de demandes hétérogènes, dont la satisfaction ou le rejet n’entretiennent, généralement, aucun lien de dépendance juridique. À la différence des litiges appelant une solution « binaire », qui sont le lot le plus habituel des juridictions de droit commun (où le sort d’une pluralité de demandes dépend, néanmoins, de la réponse apportée à une seule et même question de droit), les litiges individuels du travail donnent lieu à des décisions à la motivation nécessairement composite, dont le dispositif fait un sort différencié à chaque prétention et ne répond donc que partiellement aux attentes de chacune des deux parties. Il est alors moins étonnant que les appels des uns et des autres s’additionnent pour tenter symétriquement d’en obtenir la réformation partielle, chaque partie considérant que le succès partiel déjà remporté milite en faveur d’un appel pour le surplus. Cette observation est confortée par la part importante des réformations partielles – soit 51 % – dans l’ensemble des décisions statuant au fond en appel (contre 27,9 % de confirmations totales et 21,1 % d’infirmations totales).
On pourra, certes, souligner que l’ensemble des réformations, totales ou partielles, représente 72,1 % des décisions rendues en appel, de sorte que seraient ainsi corroborés les soupçons affectant la qualité des décisions rendues en première instance. L’hypothèse ne pourrait, cependant, être validée que par l’observation fine du contenu des décisions de réformation partielle, qui n’ont évidemment pas la même portée suivant que les décisions de première instance sont réformées du chef de prétentions principales ou seulement accessoires.
De la même manière, l’explication d’un important taux d’appel tirée d’une mauvaise qualité des décisions rendues en première instance mériterait-elle quelques éclaircissements : faudrait-il y voir la conséquence d’erreurs de jugement sur le fond ou l’imputer, seulement, à des insuffisances dans la rédaction de décisions néanmoins pertinentes et fondées ?
On le voit, si l’examen statistique du fonctionnement prud’homal s’avère un outil irremplaçable, l’interprétation des résultats nécessite rigueur et méthode, sauf à faire dire – même involontairement – à quelques chiffres ce qu’ils ne disent pas.
Des moyens indigents trop souvent passés sous silence.
Les auteurs de propositions de réforme adopteraient, sans doute, un ton plus prudent dans leurs critiques s’ils tenaient compte des conditions dans lesquelles les conseillers prud’hommes exercent leur mission.
La rédaction soigneusement motivée d’une décision de justice est un exercice d’une difficulté redoutable, y compris pour un juriste confirmé (25). Cette tâche ne s’improvise pas, elle requiert, au contraire,un apprentissage spécifique, auquel se plient les futurs magistrats professionnels au sein d’une école spécialisée après 3 à 5 années d’études supérieures ; or, c’est à ce même exercice qu’il est demandé aux conseillers prud’hommes de se livrer séance tenante, sitôt remise la médaille attestant de l’élection qui en font des juges ! C’est la question, absolument déterminante, de l’accès à la formation durant l’exercice du mandat.
Le droit individuel à la formation d’un conseiller est actuellement de six semaines, à répartir sur les cinq années de mandat, le tout sans dépasser deux semaines par année. Ces dispositifs aujourd’hui en vigueur sont quantitativement insignifiants, ils doivent être repensés et renforcés (26). Par ailleurs, les conseillers ne sont, pour la plupart, dotés ni d’un Code du travail (encore moins de procédure civile), ni d’ordinateurs – et en tout cas pas d’accès internet.
Il parait difficile de justifier une appréciation critique sur la qualité formelle des décisions prud’homales lorsque le travail est réalisé dans une telle indigence de moyens. La puissance publique fait donc preuve d’une bonne dose d’hypocrisie, sinon de cynisme, en attendant de ces juges qu’ils fassent aussi bien que leurs collègues professionnels sans être dotés d’aucun
des supports matériels et intellectuels qui sont fournis à ces derniers.
Le leurre de l’échevinage
Cette nécessaire prudence dans le diagnostic conduit à regarder avec la même circonspection l’échevinage, dont une promotion assidue fait, à nouveau, la solution évidente à l’encombrement des chambres sociales des Cours d’appel (27). L’idée paraît simple et robuste : les conseillers prud’hommes apporteront leur expérience du monde de l’entreprise et le juge professionnel apportera sa connaissance du droit du travail. Ainsi, ensemble, ils oeuvreront à la résolution du litige selon une solution inspirée par ces deux cultures (28).
Cet oecuménisme enthousiaste se heurte pourtant à une objection majeure : le litige prud’homal, comme tous les contentieux, est tranché « conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », ainsi que le prescrit l’article 12 du Code de procédure civile.
Autrement dit, seule la lecture du dossier que fait le juriste est déterminante de l’issue du litige. Quel espace et quel rôle restera-t-il alors aux conseillers, symboliquement et fonctionnellement assignés à la place des non-juristes, face au juge/juriste ?
Pourraient-ils réellement échapper à l’alternative qui se dessine trop clairement : sur-investir une opiniâtre et systématique défense syndicale ou patronale – qui les figera dans une opposition frontale et restera sans influence sur la décision – ou valider dans un consensus mou les orientations de l’expert en droit ? En réduisant le rôle des conseillers élus à celui de simples « assistants conseils », toujours départagés par un juge professionnel, cette coûteuse fausse bonne solution accentuerait ainsi le risque d’un positionnement aveuglément « partisan » des représentants de chaque collège. Ce faisant, elle viderait la prud’homie de toute sa vitalité.
Car ce qui fait la force de l’institution, c’est que les conseillers des deux collèges intègrent et partagent un langage juridique commun, dont le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe permettent de transcender l’a priori partisan pour s’accorder sur le sens de la décision à rendre. Le délibéré n’a ainsi de sens et d’intérêt que si, pour déterminer la réponse à apporter à chaque prétention, les conseillers des deux collèges, renonçant au « marchandage » auquel conduit une lecture seulement factuelle du dossier, ouvrent une discussion qui se déploie dans l’espace offert par la marge d’interprétation de la règle de droit applicable.
Ce n’est donc pas en renonçant à voir un juriste dans ce juge qu’est le conseiller prud’homme, mais, au contraire, en l’affermissant dans son statut de juriste, que l’on tirera tous les fruits d’une institution qui fait des employeurs et des travailleurs les juges de leurs pairs.
III. Le départage, signe d’échec ou composante naturelle du paritarisme ?
Depuis la loi du 27 mai 1848, les Conseils de prud’hommes sont des juridictions paritaires, dont la composition garantit l’impartialité, à la différence, notamment, des juridictions consulaires, composées de juges davantage cooptés qu’élus (et au sein desquelles le partage de voix n’est, en tout état de cause, pas concevable, les formations collégiales siégeant à trois juges) (29).
Ainsi, contrairement à ce qui est fréquemment affirmé, le départage n’est pas, par nature, symptomatique de l’échec du paritarisme ; il en est une composante à part entière, marqueur de l’impartialité de la juridiction.
Allons plus loin : le risque actuel n’est probablement pas celui d’un départage en nombre excessif, mais, dans certaines sections, celui d’un départage réduit à peau de chagrin par le souci d’un consensualisme gestionnaire. Ce risque présente incontestablement une facette juridique, comme l’ont souligné d’éminents spécialistes « Compte tenu du faible taux de départition enregistré, on réservera simplement l’hypothèse [d’un examen de conventionnalité, a priori positif, devant la CEDH de l’institution prud’homale] où des conseillers prud’hommes se seraient entendus sur le dos du justiciable et auraient sacrifié l’examen objectif du litige à la préservation d’un système fermé, excluant la présence d’un magistrat professionnel » (30). Dans le même sens, D. Boulmier relève : « le départage nous apparaît fort sain, car montrant une volonté des juges à juger et non à négocier en cours de délibéré sur le dos des parties au procès (le plus souvent au détriment des salariés) pour éviter l’incursion du juge professionnel ! » (31). Le départage traduit donc le fonctionnement normal d’une institution, qui intègre par construction des intérêts antagonistes.
Il n’est pas interdit, pour autant, d’en rechercher les causes, de décrypter les dits et non-dits de son évaluation statistique, et d’en évaluer le coût, au regard, notamment, de celui de l’échevinage dont le rapport Marshall fait la promotion.
Pourquoi le départage ?
Les motifs de départage tiennent principalement à deux grands items que sont la difficulté juridique et ce que l’on pourrait qualifier d’opposition, davantage dogmatique, entre les conseillers des deux collèges.
La composition siégeant en audience prud’homale ne réunit pas simplement quatre conseillers
représentant le monde de l’entreprise. Les conseillers prud’hommes sont issus du monde militant, syndical ou patronal ; leur jugement, comme celui de tout juge, est inévitablement influencé par leur vécu et leur sensibilité. Cette opposition militante ne nuit pas, pour autant, à la qualité du travail de la juridiction, car, les conseillers jugeant en droit, leurs raisonnements sont surdéterminés par ce droit, général et impersonnel.
Cependant, la matière est complexe et mouvante (32) : son instabilité perturbe tous les acteurs. Bien qu’aucune statistique ne soit, à notre connaissance, disponible sur le sujet, nombre de décisions de Cours d’appel sont censurées par la Cour de cassation, y compris au motif d’une violation de la loi (33). La Haute cour n’échappe pas à ces difficultés, les revirements – même peu fréquents – de sa jurisprudence en sont la preuve. Une part substantielle des recours au départage est justifiée par des difficultés d’interprétation des textes auxquelles sont confrontés les conseillers ; l’intervention d’un magistrat professionnel, bénéficiant d’une formation plus approfondie, mais aussi affranchi de l’obligation de rechercher un difficile consensus, permet alors de dénouer l’affaire.
Des conseillers du collège salarié déplorent également des situations où le partage de voix paraît résulter de positionnements davantage idéologiques que juridiques. Outre le refus de « plier » devant le droit – parfois saisi par le droit pénal, comme l’illustre l’affaire des conseillers prud’hommes du collège « employeur » de Bobigny, qui tentaient de faire observer un mandat impératif favorable à l’impunité de grande(s) entreprise(s) (34) – ces oppositions butées sont source d’allongement des procédures, incitant certains conseillers salariés à revoir à la baisse les droits du salarié dans le seul but d’éviter le partage de voix. Parmi les points de blocage les plus fréquemment évoqués figurent, notamment, l’exercice des pouvoirs du bureau de conciliation et de la formation de référé, l’indemnisation des préjudices liés à l’exposition à l’amiante, les réintégrations de salariés illicitement congédiés, les discriminations, les dossiers à fort enjeu financier, ou encore le co-emploi.
Le groupe de travail Marshall préconise que la décision constatant le départage soit motivée par l’exposé des points restant en litige (35). Cette proposition aurait le mérite de permettre de distinguer plus aisément les partages de voix découlant de difficultés juridiques de ceux qui résultent de blocages partisans. Elle est cependant surprenante. La Cour de cassation admet déjà les partages de voix partiels, la juridiction tranchant une partie du litige et ne parvenant pas à se départager pour le surplus. Dans ce cas, il n’y a aucune difficulté à identifier, dans le dispositif de la décision, les points qui ont été tranchés de ceux qui demeurent en litige. Dans les autres cas, un exposé plus précis des points demeurant en litige paraît, selon le degré de précision attendu, soit superfétatoire, soit potentiellement attentatoire au secret du délibéré.
L’importance du départage relativisée par les chiffres.
Au plan statistique, le groupe de travail Marshall place le taux de départage à 18 %, là où l’étude de Maud Guillonneau et Évelyne Serverin (36) l’évalue à 10,5 % en 2012 ; faute de disposer des données méthodologiques susceptibles d’éclairer le premier de ces deux chiffres, cette importante différence reste inexplicable. Quoi qu’il en soit, 82 % au moins des litiges sont tranchés par les conseillers prud’hommes, sans recourir à un magistrat professionnel, ce qui représente plus de 72.000 des 88.000 décisions rendues chaque année. Au demeurant, le nombre d’affaires soumises à un partage de voix est à pondérer pour tenir compte des nombreuses séries d’affaires identiques qu’il inclut, appelant, le plus souvent, une seule et même décision de principe, mais qui, par leur importance, cristallisent les oppositions entre conseillers (telles que les questions de co-emploi et d’indemnisation de la nullité des PSE, à l’instar des 680 décisions Continental du Conseil de prud’hommes de Compiègne (37)).
Enfin, d’un point de vue économique, le rapport Marshall précise que le départage dans les 16.000 affaires jugées dans cette formation représente 60 à 65 équivalents temps plein de juges professionnels (pour 209 Conseils de prud’hommes regroupant 14.000 conseillers). La « charge » du départage représenterait, ainsi, environ 1 juge à temps plein pour 3,5 Conseils
de prud’hommes, chargé de juger environ 250 affaires par an, ce qui en relativise l’impact budgétaire. À partir des mêmes données, la mise en place de l’échevinage nécessiterait, pour les 88.000 affaires jugées par an, un nombre total minimum de 360 magistrats à temps plein, soit 1,7 juge départiteur par Conseil de prud’hommes.
La création de postes de juges départiteurs en nombre très raisonnable – de l’ordre, au maximum, de quelques dizaines, comme on vient de le voir – permettrait de réduire sensiblement les délais de jugement et de respecter ceux que la loi impose dans certains cas.
IV. Délais de procédure versus règles spécifiques de procédure : la preuve par l’absurde
Les délais de jugement de certains Conseils de prud’hommes font réellement difficulté, comme en attestent les décisions du Tribunal de grande instance de Paris (38). Ceci étant, ces dysfonctionnements ne constituent qu’un symptôme d’un mal qui réside largement ailleurs que dans le régime procédural des litiges prud’homaux : on ne dira jamais assez que les capacités de traitement des affaires dépendent, avant tout, des moyens, notamment en personnel de greffe et en salles d’audience, que l’on y consacre. Le renvoi d’une affaire – lorsqu’il est objectivement nécessaire, par exemple pour garantir le contradictoire – à un mois ou, au contraire, à six mois dépend, d’abord, de l’importance du stock d’affaires elles-mêmes en attente d’être jugées, faute de greffiers ou de juges disponibles.
Les chambres sociales de certaines Cours d’appel – singulièrement à Paris où, en l’absence même de tout renvoi, une affaire ne peut être jugée qu’à l’issue d’un délai de 18 mois à 2 ans – en sont l’illustration dramatique. En atteste également le fait, alors que tous les Conseils de prud’hommes appliquent la même procédure, que les délais de jugement anormaux sont essentiellement concentrés dans ceux de Paris, de sa couronne et des grandes métropoles régionales, où le dimensionnement des juridictions n’a pas suivi l’évolution statistique du contentieux.
Il faut toutefois admettre que des améliorations pourraient résulter, au moins à la marge, d’aménagements de la procédure prud’homale. C’est ce que semble considérer le rapport Marshall, qui préconise de modifier la procédure prud’homale et relève au soutien de ses conclusions : « les acteurs concernés par le fonctionnement des CPH privilégient le maintien des fondements de cette juridiction, ne formulent guère de solutions efficaces pour réduire significativement les délais de procédure qui sont inacceptables pour les justiciables, et n’invoquent que rarement la situation de ces derniers » (39). Sur cette appréciation lapidaire, qui disqualifie en quelques mots tous les avis recueillis, le rapport préconise diverses mesures, parmi lesquelles :
- une formation obligatoire à la procédure civile, à la rédaction des jugements et à la déontologie, dispensée par l’École Nationale de la Magistrature, à défaut de laquelle les conseillers ne pourraient solliciter le renouvellement de leur mandat (40) ;
- un suivi de la procédure, incluant l’élaboration d’un calendrier de procédure, qui serait confié au greffier en charge de vérifier l’échange des pièces et « écritures » dans les délais impartis, de fixer la date de l’audience de jugement, aucune pièce ni « écriture » ne pouvant
être communiquées dans le mois le précédant (41) ;
- l’octroi d’une voix prépondérante au président d’audience pour statuer sur le suivi de la procédure, qu’il s’agisse de l’audition des parties, des renvois ou radiations (42).
Ces propositions disparates doivent être successivement appréhendées.
Les structures de formation
Personne ne songera à contester que la formation des conseillers prud’hommes devrait être obligatoire ; le simple fait d’être issu du monde du travail – et ce, quel que soit le collège d’appartenance – ne suffit pas à conférer le minimum de compétence juridique requis. Il faut, toutefois, prendre soin d’appréhender des situations hétérogènes et ce, tout en gardant à l’esprit que le renforcement de la formation ne permettra pas de résoudre tous les dépassements de délais, loin de là.
Un état des lieux précis de la formation des conseillers prud’hommes ferait probablement apparaître des disparités entre organisations syndicales : au sein des organisations de salariés, mais également entre organisations syndicales et organisations patronales.
Certaines organisations syndicales investissent plus fortement ce terrain, en instituant des formations généralisées qui font intervenir aussi bien des professionnels que des militants qualifiés ou encore les instituts du travail, l’ensemble apportant un gage de qualité. D’autres organisations dispensent peu de formations, et encore moins en matière de procédure civile, objet des préoccupations du rapport Marshall.
Pour mémoire, la loi de 1979 (43) a mis pour partie à la charge de l’État le financement de la formation des conseillers prud’hommes (44). Un décret de 1980 (45) chargea les premiers Présidents de Cours d’appel de dispenser ces formations, mais fut annulé par un décret de 1981 (46) qui réserva cette prérogative à divers organismes, dont les instituts du travail ou « les organismes à but non-lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au niveau national, se consacrant exclusivement à ladite formation ». C’est afin de répondre à cette obligation que chaque organisation s’est dotée, depuis cette époque, d’un organisme de formation de forme associative agréé. Chacun de ces organismes est lié au ministère du Travail par une convention définissant le volume d’heures de formation pouvant bénéficier d’une prise en charge financière partielle, ainsi que les contenus de ces formations.
Le Gouvernement et la Cour des comptes procèdent régulièrement à des contrôles, tant qualitatifs que quantitatifs, de l’utilisation des fonds versés. Il est donc loisible aux pouvoirs publics de déterminer avec précision quelles organisations ne dispensent pas aux conseillers prud’hommes les formations dont ils ont besoin pour assumer leur mandat. Dès lors, nul besoin de « jeter le bébé avec l’eau du bain » et de demander le transfert général des formations à la procédure à l’ENM.
L’accès à la formation
Ces questions d’identification des structures et d’évaluation de leurs responsabilités au regard des objectifs de formation n’épuisent pas le sujet et ne doivent pas occulter la question de la revalorisation très substantielle des droits à la formation des conseillers. Il est regrettable que ce thème n’ait pas plus inspiré les auteurs du rapport Marshall.
Quant au non-renouvellement du mandat des conseillers n’ayant pas suivi ces formations, cette proposition part d’un bon sentiment et a, d’ailleurs, reçu un commencement de mise en oeuvre, même en l’absence d’obligation légale par certaines organisations syndicales, dont la CGT. Il ne faut toutefois pas surestimer l’impact d’une telle exclusion dans un contexte de renouvellement des titulaires de mandat, de l’ordre de 50 % à l’occasion de chaque élection ; encadrer disciplinairement l’exécution du mandat – puisque c’est bien de cela qu’il s’agit – ne peut faire l’économie d’une réflexion sur l’épuisement ou l’abandon de certains titulaires.
L’arlésienne de la « mise en état »
Le rapport Marshall ne soutient pas l’idée, pourtant fort dans l’air du temps, de mise en place d’audiences de mise en état. Ces pratiques prévoient, le plus souvent, que soient tenues des audiences ad hoc, dites de « mise en état », entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement, le plus souvent tenues par deux conseillers décidant de mesures d’administration judiciaire.
L’institution de ces audiences par des chartes dites « contrats de procédure » est incompatible avec la procédure orale. Ces accords de principe, généralement signés par les représentants des barreaux et par les président et vice-président des Conseils, n’ont de « contrat » ou « convention » que le nom, tant il n’entre nullement dans les attributions des président et vice-président de Conseils de contracter au nom de leur juridiction et, a fortiori, au nom des conseillers (47). Ces chartes voient le jour de-ci, delà, pour pallier les réticences de certains conseillers prud’hommes à mettre en oeuvre les prérogatives légales et réglementaires qui sont les leurs.
Il appartient, en effet, au bureau de conciliation de mettre l’affaire en état d’être jugée, au besoin en ordonnant toutes les mesures d’instruction utiles.
Il s’agit même d’une condition indispensable pour que l’affaire soit renvoyée par-devant le bureau de jugement (48). Cette dimension fait partie intégrante de l’office du juge, au même titre que le rôle actif du bureau de conciliation (rappelé supra), la vérification de l’information des parties sur leurs droits respectifs et les décisions juridictionnelles provisoires visant, si ce n’est à réduire la durée globale de la procédure, à tout le moins à en atténuer les effets sur le salarié demandeur.
Cet ensemble de tâches, nécessairement chronophage, incombant au bureau de conciliation explique les dispositions réglementaires qui lui imposent de se réunir une fois par semaine au moins (49). C’est pourquoi les réticences parfois constatées à les mettre en oeuvre, au motif que le nombre d’affaires serait insuffisant, ne sont pas admissibles.
Ce raisonnement purement gestionnaire, visant à compenser des budgets dérisoires (50) et un manque chronique d’effectifs en personnel judiciaire par une restriction de l’accès au service public, atteint le droit de chacun à être jugé dans des délais raisonnables.
L’affectation en nombre suffisant de juges départiteurs – et on a vu, précédemment, que ce nombre serait très raisonnable – doit devenir une priorité, afin de permettre enfin aux juridictions prud’homales de tenir les délais prescrits par la loi, de quinze jours à compter du renvoi de l’affaire en référé, et un mois pour les audiences de conciliation et de jugement (51). Il convient de noter sur ce sujet que le délai moyen de traitement des affaires est augmenté de plus de douze mois en cas de départage (52), bien loin des délais prescrits.
(Pour) l’oralité de la procédure
L’oralité a deux vertus, l’une procédurale, l’autre pour l’universalité de l’accès à la justice. En permettant à tout justiciable qui le souhaite de se présenter seul devant la juridiction et de défendre sa cause oralement, sans avoir à maîtriser les latinismes ou autres préceptes formels, l’oralité est gage d’un égal accès de tous à la justice. Corrélativement, cette procédure orale doit aboutir à la rédaction de décisions de justice motivées, reprenant les dispositions textuelles qui les fondent, de manière à éclairer pédagogiquement le justiciable sur les raisons pour lesquelles ses prétentions sont accueillies ou rejetées.
Il n’en demeure pas moins que tout accroissement de la part de l’écrit dans la procédure réduira l’accès à la juridiction, ne serait-ce qu’en imposant à certains justiciables de se faire assister. C’est pourquoi les propositions du groupe de travail Marshall tendant à rendre la production « d’écritures » obligatoire créeraient une difficulté supplémentaire d’accès à la justice prud’homale.
Au demeurant, l’instauration d’une procédure écrite n’est en rien rendue incontournable par le choix d’instituer une mise en état, contrairement à ce qui est souvent affirmé. La difficulté à concilier une mise en état avec les spécificités de la procédure orale est, en effet, réelle, mais pas insurmontable, si l’on veut bien admettre :
- que l’oralité de la procédure n’interdit évidemment pas aux parties de consigner leurs rétentions et moyens dans un écrit (l’article R. 1454-18 évoque des « notes », soit tout document écrit), ce que confirme l’article 446-1 du CPC, aux termes duquel les parties « peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit » ;
- que, si elles décident de le faire, elles doivent évidemment en communiquer la teneur à leur adversaire « en temps utile », soit, en principe, dans le délai imparti par le calendrier de procédure ;
- que si, en revanche, elles décident de renoncer à cette faculté, sont alors applicables les dispositions de l’article 446-1 du CPC, aux termes desquelles « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ».
Autrement dit, le calendrier de procédure fixé par le bureau de conciliation pourrait très bien impartir un délai impératif de communication des pièces et « notes », à charge pour les parties de s’y conformer absolument, s’agissant des communications de pièces, et de s’y conformer, s’agissant des « notes », dans la seule mesure où elles entendraient recourir à la faculté d’en déposer. Dans ces conditions, l’épuisement du délai imparti pour conclure par écrit, sans qu’une partie ait usé de cette faculté, emporterait renonciation à y recourir et, partant, application pleine et entière du principe d’oralité, dans les conditions précisées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le droit du travail, au fil des constructions et déconstructions législatives et réglementaires, est devenu d’une complexité à la fois paradoxale et scandaleuse. Le droit, censé régir les rapports sociaux, doit pouvoir être compris de chacun des acteurs sociaux qu’il entend ordonner (53). Or, en matière de droit social, la multiplication des sources de droit, mêlant règles impératives et supplétives, le bouleversement de l’ordre public social ou encore l’éclatement des contentieux avec des règles spécifiques, font de la matière un labyrinthe pour les plus érudits praticiens.
Un professionnel qui y consacrerait toute sa carrière n’en aurait pas, pour autant, acquis toutes les subtilités et autres chausse-trapes.
Pourtant, des règles du jeu connues, comprises et cohérentes, limitent d’autant l’introduction de contentieux...
Il convient donc d’inviter le Gouvernement et le législateur à cesser de rendre inintelligible, en usant de formules magiques inopportunes, une matière qui impacte près de 18 millions de salariés et leurs employeurs, supposés comprendre, si ce n’est connaître, les règles qui régissent leurs relations réciproques.
Pour conclure, est-il interdit de s’interroger sur la qualité de la production des représentants de la nation, professionnels s’il en est de la gestion des rapports sociaux, et de la mesurer à ’aune du coût de leur élection ?
Thierry Durand et Patrick Henriot
note : Nous vous livrons ci après le lien vers le PDF de cette Doctrine ( écrit ou réflexion sur le droit ) où vous trouverez toutes les notes de renvoi trouvées ci-dessus ;
Cliquez ici : http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/29/82/42/Droit/2014-mars-couv-int.pdf
Vous y découvrirez également cette revue militante qu'est le "Droit ouvrier"
On peut évidemment s'y abonner.
-